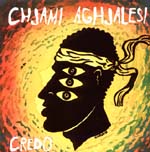| Les
chants corses, mode d'emploi... |
Le chant a toujours occupé une grande place en Corse, de la berceuse
(nanna) aux sérénades (serinati). Il existe aux côtés
de ce chant à une voix, dit " monodique ", ce que les
chants Corses peuvent avoir de plus typique, le chant polyphonique, religieux
ou profane. Commun à toute la Corse sous sa forme religieuse, le
chant polyphonique sous sa forme profane (a paghjella) vient de Haute-Corse.
Après sa diffusion depuis les années soixante-dix, il est
aujourd'hui pratiqué dans toute l'île et écouté
bien au-delà. Quel chemin, après avoir frôlé
l'oubli en Corse même, il n'y a pas cinquante ans !
Aujourd'hui, la polyphonie est peut-être non seulement le véhicule
le plus solide de l'identité Corse, mais aussi la voix la plus
expressive de l'âme insulaire, car au-delà de son originalité
dépouillée de toute instrumentation musicale, elle véhicule
l'émotion de manière presque palpable. Emotion qu'ont pu
éprouver tant le musicien américain Lou Reed, pour qui rien
n'existe de plus beau en matière de chant que la polyphonie corse,
que la regrettée Dorothy Carrington, écrivain anglais venue
s'installer en Corse dans les années 50, et pour qui la découverte
de ces chants fut une révélation : " j'avais l'impression
d'entendre la voix des entrailles de la terre, un chant venu de l'origine
du monde, celui des commencements qu'on n'ose espérer jamais accessible."
| Les
chants corses ne sont pas nés lors de l'ouverture des jeux
olympiques d'hiver à Albertville... |
La naissance du chant polyphonique se perd en effet dans la nuit des temps.
S'il est incontestablement ce que les Corses ont de plus ancien dans leur
culture, on pense que le chant grégorien l'influença au
moyen-âge, aussi loin que l'on puisse remonter. Dans la tradition
insulaire, la polyphonie est le chant de l'existence, présent à
toutes les grandes étapes de la vie (naissance, amour, travail,
sommeil, saisons, décès, etc..), il mêle le sacré
et le profane. Les polyphonies sont souvent mélancoliques, parfois
tristes comme le Blues, toujours graves, car le pays et son histoire ont
toujours été rudes.
De
tradition orale, le chant polyphonique se transmettait de père
en fils. La guerre de 14-18 où près de 30 000 corses périrent,
l'exode vers le continent et les colonies qui suivit, ont causé
un tel vide dans de nombreux villages que les maillons de la chaîne
ont souvent été rompus tandis que l'influence du continent
qui poussait à l'abandon de la langue et des traditions corses
ont fait le reste. La tradition a tout de même réussi à
se maintenir, de deux façons: dans certaines régions qui
ont peu subi les influences extérieures (comme les villages de
Sermanu, de Rusiu et de Tagliu Isulaccia), mais aussi à l'extérieur
de la Corse, comme à Nice, où beaucoup d'étudiants
corses se retrouvaient à l'université dans les années
70. Le chanteur Pierre-Ange Agostini raconte que son frère y apprit
le chant polyphonique au contact d'autres Corses et que revenu dans son
village, il l'initia à son tour.
| Les
trois formes du chant corse sont quatre... et même cinq ! |
Depuis toujours, le chant polyphonique, à côté
de son rôle sacré, est au service de textes ou d'improvisations
poétiques, au point de parfois se confondre: lamentu, terzetti,
et paghjella, autant de chants profanes. U lamentu est une complainte,
que ce soit de l'exil, d'un amour malheureux ou de quelque événement
douloureux; les terzetti sont des chants en couplets de trois vers,
écrits en toscan et datant du moyen-âge; enfin, la paghjella
est un sizain octosyllabique qui a donné son nom à la
façon la plus répandue de chanter les poèmes,
quels qu'il soient (lamenti...), et in fine, par extension, à
tous les chants polyphoniques traditionnels, chant sacré inclus.
A paghjella est un choeur constitué de trois voix (parfois
deux ou quatre), où, à part la tierce, les autres parties
vont à l'unisson. A siconda, la voix principale / le baryton,
entonne le chant. U bassu (ou u boldu, selon la région) est
la voix plus grave qui enchaîne. A terza, la tierce, est la
voix la plus haute qui s'ajoute aux précédentes en respectant
un intervalle de temps, tout en les enrichissant des ribuccati, les
ornementations et modulations, qui donnent un côté "
oriental " au chant. Petru Guelfucci est peut-être le plus
grand chanteur dans ce domaine.
N'oublions pas un autre chant très particulier: les chjam'è
rispondi, appels et réponses. Il s'agit d'un dialogue voire
d'une joute orale, sur le mode de la poésie improvisée,
que nos bergers d'antan - qui chantaient des passages de la Divine
Comédie - s'échangeaient parfois d'un versant d'une
montagne à l'autre, et que chantent encore certains Corses
des montagnes quand ils se retrouvent autour d'un verre au café
du village. Ce divertissement remonte à l'antiquité,
comme en a témoigné Virgile. En revanche, le Voceru
(ou Vuciariu, selon la région), chant funèbre improvisé
par les femmes au chevet du défunt, n'a pas résisté
au travail du temps, même s'il reste dans la postérité
pour son apport à la langue... française (" vocératrice
" est issue de vuceratrice).
Ainsi, en Corse, le chant est non seulement un divertissement ou une
exploration artistique, mais un mode de communication de premier ordre
au sein d'une société de tradition orale, qui a aujourd'hui
encore ses porte-voix de talent.
La
collèque de têtes de Maure
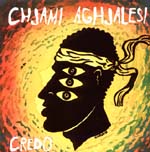
Di Rosa pour Chjami Aghjalesi |
|